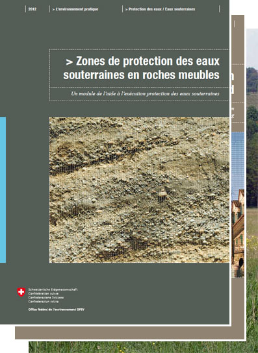En bref
En Suisse, la distribution de l’eau potable à la population est une tâche qui incombe aux communes. Ces dernières doivent garantir un approvisionnement en eau de qualité, que ce soit d’un point de vue chimique ou microbiologique, et en quantité suffisante.
Le canton du Valais, en particulier le Service de la consommation et affaires vétérinaires (SCAV) surveille le bon fonctionnement des services des eaux communaux et effectue des inspections et des prélèvements afin de contrôler la qualité de l’eau potable.
En Suisse, la grande majorité (80%) de l’eau potable provient des eaux souterraines. En Valais, cette part est encore plus importante, d’où l’importance d’une protection efficace de la nappe phréatique. L’eau potable sert également en cas d’incendie comme eau d’extinction aux pompiers.
Depuis le début des années 80, la consommation d’eau potable par personne a diminué de 40% environ en Suisse. Cela s’explique par une utilisation plus efficace de l’eau, des mesures d’économie de l’eau et la délocalisation d’une partie des sites de production industrielle.
A l’avenir, plusieurs défis se poseront quant à l’approvisionnement en eau potable. Le changement climatique risque de modifier la recharge des nappes phréatiques ainsi que la fréquence des épisodes de sécheresse. Le traitement des micropolluants issus de l’industrie, de l’agriculture et des ménages sera également un défi afin de garantir une eau potable de qualité.
Eau potable - Données
| Paramètres | Valeurs limites |
| Température | 25 °C |
| pH | 6.8 – 8.2 |
| Ammonium | 0.5 mg/l |
| Arsenic | 10 μg/l |
| Nitrites | 0.1 mg/l |
| Nitrates | 40 mg/l |
| Sodium | 200 mg/l |
| Germes aérobies mésophiles | 300 UFC/ml |
| Escherichia coli | 0/100 ml |
| Entérocoques | 0/100 ml |
Dureté de l’eau en Valais

Dureté de l'eau par commune en degré français en Valais. Date de publication: 11.09.2019. Source: Département de la santé, des affaires sociales et de la culture. DSSC
Différentes géodonnées en lien avec l'eau potable sont disponibles et peuvent être consultées sur les géoportails suivants:
Eau potable - Indicateurs
Consommation d'eau potable
Consommation des ménages, des petites entreprises, de l'industrie, de l'artisanat, des services publics, des fontaines, consommation propre des distributeurs et pertes. Source : Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE). Date de publication: 16.06.2022. © OFS 2022
Consommation d’eau potable totale (eau fournie par les distributeurs publics)
Source : Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE). Date de publication: 15.02.2022 © OFS 2022
Eau potable captée et origine de l’eau potable
Volume total d'eau captée en millions de m3 (axe de gauche) et origine de cette en eau en pourcent (axe de droite). © OFS 2023
Indicateurs Eaux calculés par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)
Les indicateurs sélectionnés évaluent et illustrent l'état et l'évolution de l'environnement dans le domaine des eaux à l'aide d'une sélection de grandeurs-clés.
© Office fédéral de l'environnement. OFEV 2023
Eau potable - Bases légales et directives
Suisse
- Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991
- Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl) du 20 juin 2014
- Ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) du 20 novembre 1991
- Ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD) du 16 décembre 2016
Valais
- Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) du 16 mai 2013
- Ordonnance concernant les installations d’alimentation en eau potable du 21 décembre 2016
Directives de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE)
- W1 – Directives pour la surveillance qualité de la distribution d’eau
- W2 – Directive pour l’assurance-qualité dans les zones de protection des eaux souterraines
- W3 – Directive pour installations d’eau potable
- W3/C1 – Complément 1 : Directive Protection contre les retours d’eau dans les installations sanitaires
- W3/C2 – Complément 2 : Directive Exploitation et maintenance des installations sanitaires
- W3/C3 – Complément 3 : Directive pour l’hygiène dans les installations d’eau potable
- W4 – Directive sur la distribution d’eau
- W5 – Directive pour l’alimentation en eau d’extinction
- W6 – Directive pour l’étude, la construction et l’exploitation de réservoirs d’eau
- W10 – Directive pour l’étude, l’établissement et l’exploitation de captages de sources
- W11 – Directive pour l’établissement d’un cahier des charges pour fontainier
- W12 – Guide des bonnes pratiques destiné aux distributeurs d’eau potable
- W13 – Directive Désinfection de l’eau potable aux UV
- GW1 – Directive pour l’exécution des installations intérieures pour le gaz et l’eau potable
- GW2 – Partie A : Directive pour la prévention des accidents et la protection de la santé dans les branches du gaz et de l’eau
- GW2 – Partie B : Directive pour la prévention des accidents et la protection de la santé dans les branches du gaz et de l’eau
Directives communales - Sion
Directives communales - Val de Bagnes
Organisation mondial de la santé (OMS)
Eau potable - Etudes et projets
MontanAqua
Le projet MontanAqua avait pour but d’étudier la gestion de la ressource en eau dans la région de Crans-Montana et Sierre.
Dans un premier temps, les chercheurs ont analysé la disponibilité actuelle de la ressource et la répartition entre les différents utilisateurs (hydroélectricité, tourisme, eau potable, agriculture). L’impact du changement climatique sur les ressources en eau a également été étudié.
Programme national de recherche
Le programme national de recherche PNR 61 qui a eu lieu entre 2008 et 2014 avait comme thème central la gestion durable de l'eau. En plus de MontanAqua, différents projets de recherche ayant un lien direct ou indirect avec l'eau potable y ont été mené au niveau suisse. Les projets suivants sont notamment dignes d'intérêt pour les questions d'eau potable:
- DROUGHT-CH: Sommes-nous préparés aux périodes de sécheresse?
- GW-TEMP: Comprendre les effets du changement climatique sur les eaux souterraines
- GW-TREND: Pénurie d’eau souterraine due au changement climatique?
- RIBACLIM: L’eau potable provenant des rivières est-elle encore suffisamment propre?
- SWIP: Planification à long terme d’infrastructures durables de distribution et de traitement de l’eau
- SWISSKARST: Les eaux karstiques, une ressource hydrique pour le futur?
La page suivante regroupe les différentes publications qui ont été faites à l'échelle du programme de recherche.
RégiEau
Le projet RégiEau avait pour but d’étudier l’interconnexion des réseaux d’eau potable afin de valoriser de potentiels surplus d’eau gravitaire des communes d’altitude et de réduire l’impact énergétique dû au pompage des communes de plaine.
AlpEau
Le projet Interreg franco-suisse ALPEAU s'est intéressé aux interactions entre la forêt et l’eau potable avec différents cas d'étude en Suisse romande et en France voisine. Le but était de mieux comprendre le rôle protecteur de la forêt pour la préservation des ressources en eau potable.
Reportages dans les coulisses de la gestion de l'eau potable
Le Walliser Bote a tourné deux vidéos en 2021 dans la commune de Viège. Les reportages mettent en lumière les différents corps de métier qui garantissent la qualité de l’eau potable distribuée aux consommateurs valaisans, à l'image de l'inspecteur des eaux du SCAV, du fontainier, du responsable communal, et du laboratoire cantonal.
Eau potable - Publications
 Le plan directeur cantonal est l’instrument de coordination des diverses activités qui ont un impact sur le territoire. Le but est de coordonner les différentes activités qui ont lieu sur un même territoire, d’offrir un cadre de travail adéquat et qui tienne compte des évolutions et finalement de mettre en œuvre la politique cantonale en matière d’aménagement du territoire. Il se compose d’une carte et de fiches, réparties en neuf domaines d’activité, dont celles concernant l'eau potable:
Le plan directeur cantonal est l’instrument de coordination des diverses activités qui ont un impact sur le territoire. Le but est de coordonner les différentes activités qui ont lieu sur un même territoire, d’offrir un cadre de travail adéquat et qui tienne compte des évolutions et finalement de mettre en œuvre la politique cantonale en matière d’aménagement du territoire. Il se compose d’une carte et de fiches, réparties en neuf domaines d’activité, dont celles concernant l'eau potable:
E.2 Approvisionnement et protection des eaux potables
Un module de l’aide à l’exécution Protection des eaux souterraines
La publication « Protection des eaux souterraines : aquifères karstiques et fissurés fortement hétérogènes » est un module de l’aide à l’exécution «Protection des eaux souterraines , élaborée par la Confédération. Elle a pour objectif l’uniformisation, au niveau national, des mesures en matière de protection des eaux souterraines. Cette aide à l’exécution décrit les principes de délimitation des zones de protection des eaux souterraines (S1, S2, Sh, Sm) dans les régions caractérisées par des aquifères karstiques et fissurés fortement hétérogènes. En outre, elle indique les mesures de protection et les restrictions d’utilisation applicables aux zones Sh et Sm. Cette aide à l’exécution est destinée en premier lieu aux autorités d’exécution ainsi qu’aux services des eaux et aux bureaux de conseil et d’ingénieurs en géologie.
L’eau potable est le produit alimentaire le plus précieux qui soit, ce qui fait de l’approvisionnement en eau potable une infrastructure critique. La haute surveillance de cet approvisionnement incombe aux cantons, tandis que les communes ont pour mission de garantir à la population un accès à l’eau potable. En cas de pénurie grave, ce sont les cantons qui sont chargés d’assurer l’approvisionnement en eau potable.
L’ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement en eau potablelors d’une pénurie grave (OAP) est entrée en vigueur le 1er octobre 2020. Cette brochure a pour vocation d’informer les cantons, les services des eaux ainsi que d’autres organisations des principales dispositions de l’OAP et de souligner les nouveautés de ce texte par rapport à l’ancienne ordonnance.
Objectifs et mesures recommandées.
Les conclusions du projet «Approvisionnement en eau 2025» montrent que malgré les changements climatiques, il restera à l’avenir en Suisse suffisamment d’eau de bonne qualité pour couvrir les besoins en eau potable, en eau d’extinction et en eau d’usage. Il est nécessaire de répartir intelligemment l’eau à disposition et d’accroître la sécurité
en matière d’approvisionnement.
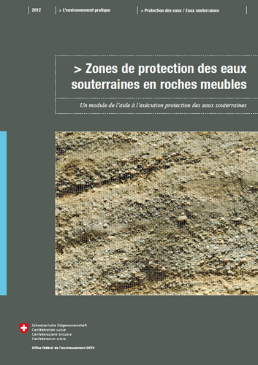 Ce module présente la marche à suivre pour délimiter les zones de protection des eaux souterraines dans les roches meubles. La procédure prévue se déroule par étapes: les investigations pour délimiter les zones de protection nécessitent tout d’abord un contrôle d’adéquation destiné à déterminer l’utilité d’un emplacement de captage. Il convient d’accorder une attention particulière à l’identification et à l’évaluation du danger potentiel.
Ce module présente la marche à suivre pour délimiter les zones de protection des eaux souterraines dans les roches meubles. La procédure prévue se déroule par étapes: les investigations pour délimiter les zones de protection nécessitent tout d’abord un contrôle d’adéquation destiné à déterminer l’utilité d’un emplacement de captage. Il convient d’accorder une attention particulière à l’identification et à l’évaluation du danger potentiel.
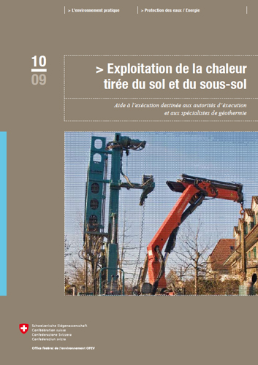 Cette aide à l’exécution vise à harmoniser l’octroi d’autorisations en faveur de sondes géothermiques, pompes à chaleur eau-eau, circuits enterrés, corbeilles géothermiques et pieux énergétiques en Suisse. Elle fixe également les mesures de protection à mettre en oeuvre en vertu de la législation sur la protection des eaux. Mais elle ne porte pas sur la géothermie à grande profondeur, dont l’autorisation requiert un examen au cas par cas. Cette aide à l’exécution est destinée en premier lieu aux autorités d’exécution et aux spécialistes de l’énergie géothermique, ainsi qu’aux maîtres d’ouvrages intéressés.
Cette aide à l’exécution vise à harmoniser l’octroi d’autorisations en faveur de sondes géothermiques, pompes à chaleur eau-eau, circuits enterrés, corbeilles géothermiques et pieux énergétiques en Suisse. Elle fixe également les mesures de protection à mettre en oeuvre en vertu de la législation sur la protection des eaux. Mais elle ne porte pas sur la géothermie à grande profondeur, dont l’autorisation requiert un examen au cas par cas. Cette aide à l’exécution est destinée en premier lieu aux autorités d’exécution et aux spécialistes de l’énergie géothermique, ainsi qu’aux maîtres d’ouvrages intéressés.
Les aires d'alimentation Zu sont délimitées pour protéger les captages d'eau potable des pollutions dues aux nitrates, aux produits phytosanitaires et à d'autres substances. Le guide pratique présente les bases, les méthodes d'analyse et les procédés utiles pour leur dimensionnement.
 La méthode multicritère EPIK a été établie pour cartographier de manière générale la vulnérabilité des aquifères karstiques et plus spécifiquement celle des bassins d'alimentation des sources ou captages en milieu karstique. La carte de vulnérabilité obtenue constitue ainsi une base indispensable pour la délimitation des zones de protection.
La méthode multicritère EPIK a été établie pour cartographier de manière générale la vulnérabilité des aquifères karstiques et plus spécifiquement celle des bassins d'alimentation des sources ou captages en milieu karstique. La carte de vulnérabilité obtenue constitue ainsi une base indispensable pour la délimitation des zones de protection.
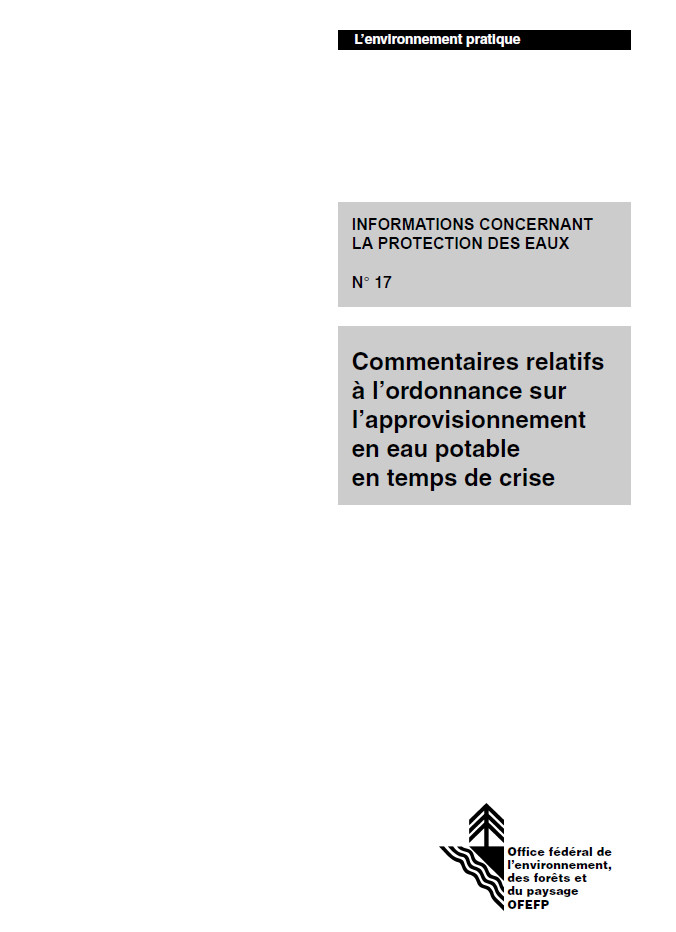 Le présent commentaire traite des réflexions fondamentales qui ont conduit à l'ordonnance sur l'approvisionnement en eau potable en temps de crise, de la répartition des tâches entre Confédération, canton et communes et des tâches
Le présent commentaire traite des réflexions fondamentales qui ont conduit à l'ordonnance sur l'approvisionnement en eau potable en temps de crise, de la répartition des tâches entre Confédération, canton et communes et des tâches
incombant directement à la Confédération, Les responsabilités des cantons et des communes ne sont qu'esquissées.
Eau potable - Liens utiles
Portail Eau
Le portail Eau proposé par la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) regroupe diverses informations en relation avec l'eau potable. On peut notamment y trouver:
- Un site didactique sur l'eau potable
- La revue spécialisée Aqua & Gas
Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA)
Cette association diffuse de nombreuses informations liées à la protection des eaux, celles-ci sont destinées en premier lieu aux professionnels.
Eau potable - Contact
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV)
Service de l’environnement (SEN) - Section Protection des eaux
Service de l’environnement (SEN) - Groupe Eaux souterraines
Office fédéral de l'environnement (OFEV) - Division Eaux
Office fédéral de l'environnement (OFEV) - Division Hydrologie